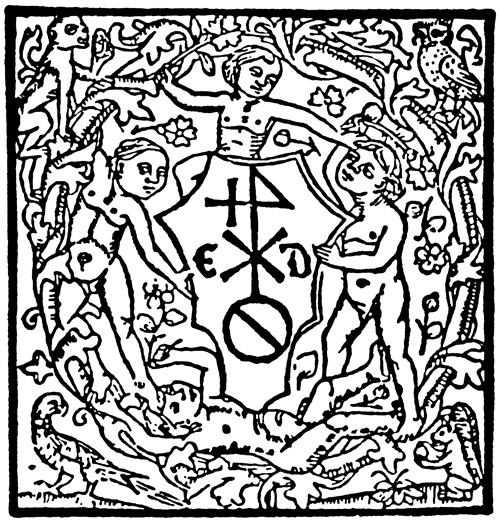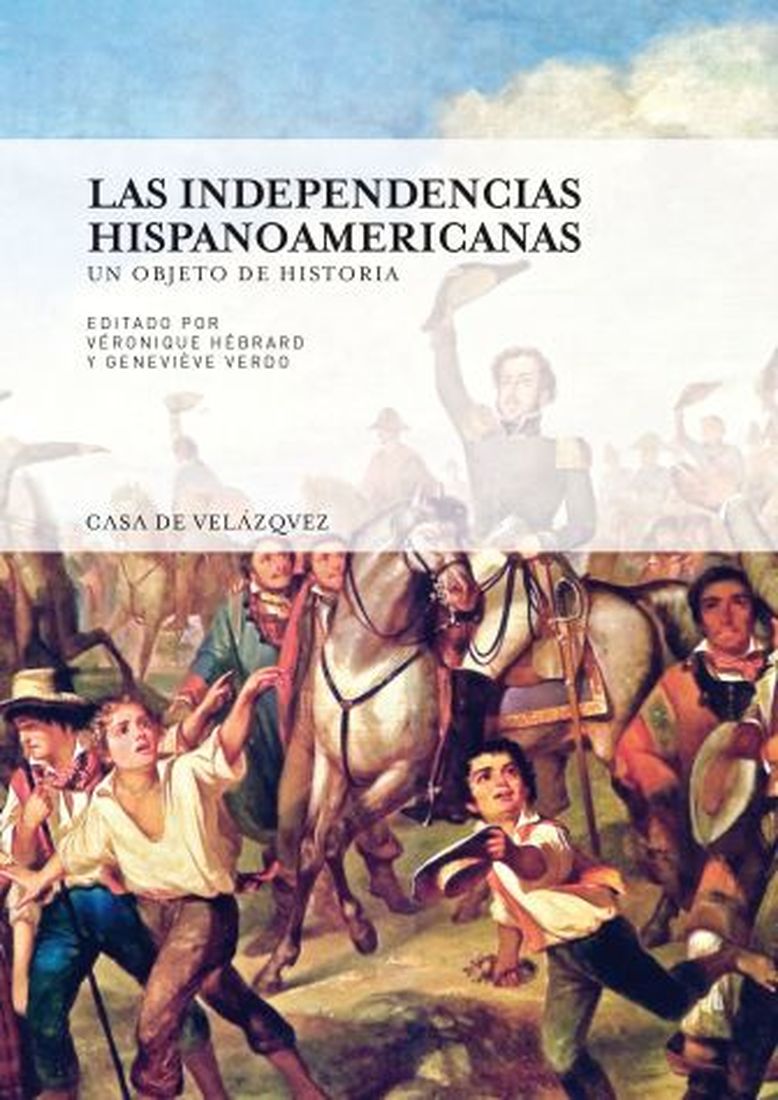XIXe siècle
Sur le conseil de ses médecins, Rodolphe Töpffer quitte précipitamment Genève le 25 juin 1843 pour se rendre seul à Lavey, dans le canton de Vaud, afin de suivre une cure destinée à améliorer l’état de ses yeux ! Il s’y trouve avec nombre de Genevois de la bonne société, de Suisses et d’étrangers, ce qui lui donne l’occasion, dans ses lettres journalières adressées à sa femme, d’émettre des opinions humoristiques sur ses compagnons de cure. Töpffer organise pour eux une promenade dans les environs, qu’il narrera dans les Souvenirs de Lavey, vendus au profit des pauvres du village.
Par ailleurs, Töpffer et son cousin Jacques-Julien Dubochet, l’éditeur parisien, échangent une série importante de lettres relatives à la parution, fin 1843, des fameux Voyages en zigzag, puis à l’édition des Nouvelles genevoises illustrées et à celle du Presbytère.
Malheureusement, la santé de Rodolphe se dégrade assez rapidement, et ses médecins lui recommandent une nouvelle cure, cette fois à Vichy, ce qui entraîne en été 1844 une seconde série de lettres à sa femme, demeurée à Genève avec ses enfants. Le présent volume en reproduit la première partie.
Dans la lignée de l'empirisme des Lumières, l'observation clinique devient au XIXe siècle la métaphore dominante, voire obsédante d'une herméneutique littéraire tournée vers l'exploration du social et de l'humain, et qui revendique l'autorité d'un savoir. Parallèlement et progressivement, la médecine est invitée à instaurer la norme et à poser les limites entre santé et maladie, raison et folie – norme et limites qu'elle peut également déplacer et contester. Le regard clinique, révélateur des pathologies sociales et individuelles, peut également conduire à la conception d'un ordre nouveau, où les pathologies seraient guéries. Toutefois la littérature met en question, aussi souvent au moins qu'elle l'asserte, la capacité du médecin ou de ses avatars métaphoriques à résoudre les problèmes de l'homme et de la société, et souligne parfois les dérives inquiétantes d'un pouvoir médical normatif.
Le présent recueil s'intéresse dans sa première partie au médecin comme figure de l'interprète dans un certain nombre de corpus littéraires (Balzac, le roman-feuilleton, le roman policier...). Dans sa deuxième partie, il explore la constitution d'une normalité par le biais de la médecine, et sa mise en question médicale et littéraire. Enfin la troisième partie montre comment se développe, après 1850 surtout, dans les représentations littéraires, une conscience grandissante des limites du pouvoir médical, voire une mise en question de sa légitimité, dans le cadre, toutefois, d'une fascination inentamée.
TABLE DES MATIÈRES
Remerciements
Présentation du volume III, par Lise Dumasy-Queffélec
Présentation des auteurs du volume III
Sommaire du volume III
PREMIÈRE PARTIE: LES MODÈLES DU SAVOIR. POSITIVISME, DARWINISME: PUISSANCES ET CONTESTATIONS
Annie Petit,
Médecine et positivisme : une troublante fascination
Regina Pozzi,
Sciences de la vie et sciences de l’homme : le projet scientifique de Taine
Nicolas Gallois,
Darwinisme et économistes français : un amour déraisonné ?
Sandrine Schiano-Bennis,
L’incidence idéologique et épistémologique de la pensée de Darwin au sein du discours littéraire à la fin du xixe siècle :
triomphes et contestations
Marc Guillaumie,
Fiction préhistorique et darwinisme : amour impossible ou mariage blanc ?
Claire Le Guillou,
La Fille du singe ou Maurice Sand aux prises avec le roman évolutionniste
Stéphanie Dord-Crouslé,
Bouvard, Pécuchet et la « vache désespérée » : le magnétisme entre savoir et farce
DEUXIÈME PARTIE: FIGURATIONS LITTÉRAIRES DU MÉDECIN ET DE LA MÉDECINE
Stéphane Arthur,
La science du drame romantique : médecin et alchimiste dans les drames de l’époque romantique représentant
le seizième siècle
Nicolas Gauthier,
Le médecin dans les « mystères urbains » (1840-1860)
Elise Radix,
Du médecin au savant chez Zola : genèse des personnages prométhéens
Agnès Sandras,
Les médecins romanciers (1880-1900)
Charles Grivel,
Georges Barral (avec Dubut de Laforest) : le Faust du naturalisme
Marie-Odile Salati,
« Les carabins ont perdu l’esprit » dans la nouvelle Herbert West, Réanimateur de H. P. Lovecraft (1922)
Anne-Lise Perotto,
Modelages : les figures du médecin et de l’auteur dans L’Ile du docteur Moreau de Herbert George Wells
Gayaneh Armaganian-Le Vu,
Les médecins-écrivains dans la littérature russe : une Historia morbi ou une histoire de vie ?
Frédérique Leblanc,
Le médecin de famille dans les classes populaires : renforcement de son efficacité et maintien de la distance
sociale
Vincent Bruyère,
Ouvrir le corps : naissance d’un regard
Joël July,
Vacation littéraire du médecin Bruno Sachs, chez Martin Winckler : réflexions sur les digressions dans le premier roman de la trilogie de Martin Winckler La Vacation (1989)
Gérard Danou,
Soigner « au coeur des ténèbres », une lecture du roman de Damon Galgut : Un docteur irréprochable
TROISIÈME PARTIE: PARCOURS BIOGRAPHIQUES EXEMPLAIRES
André Bolzinger,
Le citoyen Percy et le modèle médical issu de 1789
Lucia Ofrim,
Le Docteur Francisc Rainer à la recherche de la forme vivante
Muriel Salle,
L’étrange cas du docteur Lacassagne en sa bibliothèque
Annie Petit,
Emile Littré, médecin et historien
Index des noms de personnes cités
Index des titres d’oeuvres cités
Table générale des matières_
Troisième volume d’un ensemble de travaux publié sous le titre Médecine, Sciences de la vie et Littérature en France et en Europe, de la Révolution à nos jours, le présent livre entreprend d’interroger la double modalité –
euphorique et dysphorique – du rapport de l’imaginaire collectif à la science et au progrès, telle qu’elle s’est développée au sein des représentations collectives depuis le tournant des Lumières jusqu’à nos jours. Pour ce faire, il s’intéresse aux modèles du savoir issus des sciences de la vie et à leur diffraction dans le discours littéraire, ainsi qu’aux figures diverses du médecin dans leur rapport avec celles de l’écrivain ; enfin, une dernière partie intitulée «Parcours biographiques exemplaires» retrace, à travers la trajectoire de quatre figures représentatives, la diversité des rapports qu’entretiennent, durant toute la période considérée, littérature et médecine.
Alors que le champ éditorial français accueille, depuis le début du XXIe siècle, des fictions longues, marquées par l’héritage distancé de romans qui dialoguent avec l’Histoire, le point de vue macrogénétique développé ici s’attache à l’invention par Balzac d’une forme neuve, l’Œuvre-monde, qui constitue un modèle d’écriture productif pour ses successeurs. Il s’agit de faire référence et concurrence au réel, au moyen de rapports nouveaux entretenus avec lui.
L’étude s’attache aux modèles d’écriture disponibles au temps de Balzac, hérités du XVIIIe siècle et développés par le monde éditorial du premier XIXe siècle: modèles historiques, scientifiques, historio - graphiques que le travail balzacien s’approprie et reconfigure. Plusieurs modèles d’organisation des oeuvres longues sont ainsi mis en évidence, grâce à l’examen des étapes qui conduisent à La Comédie humaine telle qu’elle commence à paraître en 1842: un modèle sériel historique présent dans l’Histoire de France pittoresque, un modèle panoptique qui préside au projet d’Etudes sociales. A terme, la singulière forme-sens balzacienne peut être saisie comme un texte fondé sur une porosité généralisée, qui permet de «penser par cas». La logique qui traverse les séries d’Etudes, en voie de fusion dans l’oeuvre longue, relève d’un principe d’abolition des schèmes verticaux, des pyramides de tous ordres.
Le tissage du texte de La Comédie humaine, considéré dans son entier, fait apparaître une poétique neuve, où il s’agit bien de «faire vrai» et non de construire du vraisemblable. L’agencement singulier qui s’invente ainsi, à l’âge démocratique, est lié au caprice du vivant: à la contingence et à ses aléas.
TABLE DES MATIÈRES
Première partie
FORCLUSION ET FORMALISME :
LA CARTOGRAPHIE ANALYTIQUE
Chapitre premier. La méthode comme démarche spéculaire : Le risque du figement
La reprise valéryenne de la mathesis universalis de Descartes
De l’Ars magna de Raymond Lulle à la Lingua generalis de Leibniz
Du formalisme de Hilbert à la machine de Turing
Les Narcisses valéryens : de la spécularité à la normopathie
La "pensée" comme perte du "penser" chez Michaux
Chapitre II. Du pouvoir scopique au voeu d’intégration
Le modèle du déterminisme de Laplace chez Valéry et le Moi – Redivivus
Gladiator : la volonté de possession
Du souci cadastral à l’héritage de l’atman chez Segalen
Chapitre III. Organisme et symétrie
Les "degrés de symétrie" de Léonard et de Teste
La consistency de Poe
Plis et symétries de Mallarmé
Du modèle réflexe à la "symétrie agitée" chez Valéry
Deuxième partie
LES FRAGMENTATIONS DE L’ÉDIFICE
Chapitre premier. La césure du spéculatif
Le cogito kantien: "je" est une coquille vide
La conscience malheureuse d’Hölderlin
Le contre-cogito-valéryen : la self-variance
Valéry et Artaud, figures de la pensée convulsive
Chapitre II. Principes de la cruauté et de la défiguration: "forcener les subjectiles", déformer les figures
L’oeil noir de Valéry
Investir les frontières, dissoudre les limites : vers une pensée de la force chez Artaud et Valéry
Le travail diagrammatique, la force oubliée du signe
Axiomatisation et empiètement
"Désemparer la figure"
Chapitre III. L’hétéropoïétique, le "jeu" du déterminisme
Mallarmé : hasard contre nécessité
Briser le cercle du Même : le surgissement de l’autre chez Valéry
Echapper aux coordonnées : le clinamen de Michaux, l'"antipode boréen" de Segalen
Troisième partie
LA CARTOGRAPHIE POÉTIQUE :
LES AVATARS DU POÏEIN
Chapitre premier. L’esthétique valéryenne de la danse .
La danse: un art transcendantal?
La danse hors la scène: la "philosophie" valéryenne de la danse
"De la danse" à "L'infini esthétique"
L’intensité de la danse : une « poésie générale des actions humaines"
Un espace-temps sans dehors
Chapitre II. L’espace de l’extase : l’apport de l’esthétique de Straus à la compréhension du poïein valéryen
Espace lisse et espace strié
Son et espace originaire
Aisthèsis et poïesis
Merleau-Ponty et Valéry : l’expression ou le sentir
L’esthétique comme dévoilement progressif : de Hegel à Klee, Straus et Valéry
Esthétique, épistémologie et poïétique (Straus, Mach, Valéry et Michaux)
Chapitre III. La cartographie de l’informe chez Georges Bataille : le signe comme symptôme dans Documents
La notion de dépense comme inclination vers le processus
Aspects de la poétique bataillienne de l’informe dans Documents
Chapitre IV. Le tracé du hiéroglyphe : la danseuse de Mallarmé
Mallarmé et le rituel de l’Idée
Le Ballet, plutôt que le théâtre ou la musique
Conclusion
Bibliographie des ouvrages et articles consultés
Index
Sous le nom de « cartographie poétique », ce livre entend décrire une conception de la création commune à des écrivains, essayistes et poètes, comme à des peintres, des philosophes et des scientifiques. Cette création échappe à l’intelligence de type déductiviste, à la pensée du programme, pour s’affirmer comme imprévisibilité et puissance inductrice susceptible de s’épanouir dans des rythmes, des tracés ou des enchaînements conceptuels. C’est donc aussi à une critique de la pensée analytique que cet essai se livre, afin d’en cerner les impasses et les empêchements et de promouvoir une dialectique ouverte qui est contact du sujet créateur avec un monde qui le colore, dans le mouvement même où celui-là le cartographie. La dite cartographie, s’employant à cerner les ressources de l’esprit en acte, en vient à ne pas se limiter à une topographie mentale, forcément réductrice, pour embrasser, à l’instar de Valéry, la triade du « Corps-Esprit-Monde » et en traduire les intersections. La figure de ce sujet cartographe est idéalement la danseuse, incarnation d’une subjectivité rénovée par l’extase.
En fondant un conservatoire de musique dans sa ville natale, François Bartholony pensait consolider l'harmonie civique. Pour "nationaliser" la musique à Genève, il imagina d'importer des partitions sérieuses (signées Haendel, Mozart ou Beethoven), de mettre en place une discipline stricte de l'apprentissage et de faire du solfège la clef de voûte de l'édifice. Dans l'enceinte de l'école, le comité de notables philanthropes dont il s'était entouré imposa non sans mal dans les classes l'abandon des romances et des pièces de salon, la soumission des élèves (jeunes filles de bonnes familles pour la plupart) aux examens et des professeurs aux inspections. Mais le nouvel établissement ne remplaça jamais totalement le riche tissu d'institutions parallèles (Société de Musique, écoles de catéchumènes, Société de Chant sacré, etc...) et de maîtres privés qui oeuvraient eux aussi à former des amateurs. En s'enfonçant dans les archives - celles de l'école et surtout celles réputées peu musicales des Archives d'État ou de la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève, on découvre la vivacité de ces formes d'initiation à la musique ainsi que les aléas du projet bartholonien. Un projet dont l'histoire est bien plus sinueuse que le racontaient les discours officiels. L'institution d'une nouvelle manière de faire la musique, devenue la nôtre, ne s'est en effet imposée que lentement, au prix d'un travail permanent d'ajustement du dessein initial du fondateur à une cité artistique et sociale en perpétuelle transformation. Le but de cette enquête est de mettre en lumière ces déplacements, tout en restituant un conservatoire "en situation", autrement dit en n'isolant pas l'école de musique genevoise du monde dans lequel elle s'insérait.